Contexte du Projet
Bien qu’ayant l’une des économies les plus diversifiées de toute la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la croissance du PIB réel de l’activité économique du Cameroun a légèrement ralenti en 2019 par rapport à 2018 (4,0 % contre 4,1 % respectivement) en raison du déclin des secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie à forte intensité de main-d’œuvre affectés par la crise sociopolitique dans les régions anglophones (Nord-Ouest et Sud-Ouest). Le Cameroun est également aux prises avec les attaques de Boko Haram dans l’Extrême-Nord, en plus du fait qu’on observe un afflux de réfugiés en provenance de la République centrafricaine (RCA) dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord. Les chiffres de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) montrent que le Cameroun accueille, au 30 juin 2020, plus de 414 852 réfugiés, principalement en provenance de la RCA et du Nigeria. La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 a un impact négatif sur l’économie du Cameroun, principalement en raison de la baisse de la demande mondiale, de la flambée des prix des principaux produits d’exportation du pays (pétrole, café, cacao, coton, aluminium et caoutchouc), ainsi que de la forte contraction des secteurs de l’hôtellerie et des transports.
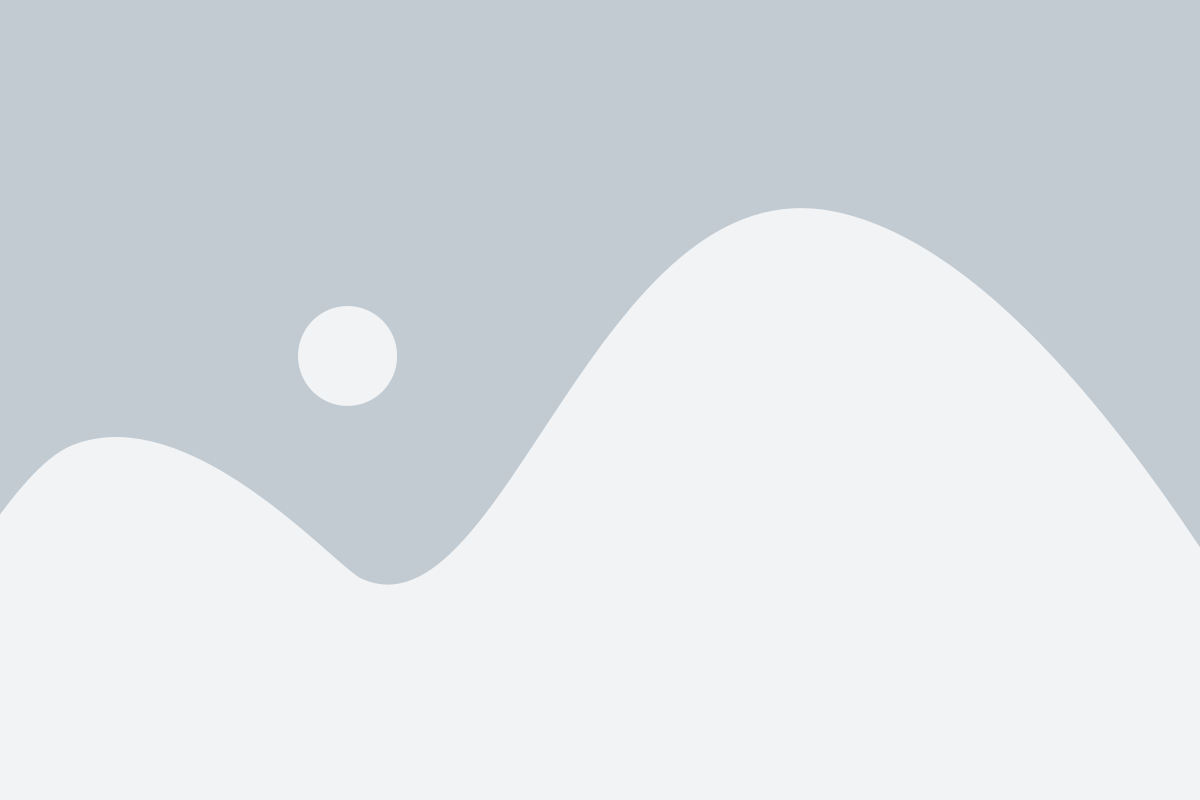
Si le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE, 2009) a identifié l’insuffisance des infrastructures et un environnement commercial défavorable comme principaux facteurs entravant la croissance économique et la création d’emplois, il n’en demeure pas moins que le secteur agricole, qui emploie environ 70 % de la population active au Cameroun, pourrait constituer le moteur de la croissance économique et de la création d’emplois, à condition que le pays passe d’une agriculture traditionnelle à une agriculture diversifiée et commercialement viable.
Cependant, la croissance démographique étant plus rapide que la réduction de la pauvreté, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté dans certaines régions du Cameroun dont celles du Nord et de l’Extrême-Nord. Celles-ci affichent de loin les taux de pauvreté les plus élevés du Cameroun, avec environ 56 %.
Dans la zone soudano-sahélienne, largement aride, qui comprend les régions de l’Extrême-Nord et du Nord, la production agricole (mil, maïs, arachides et coton) dépend fortement des précipitations. La production animale est également vulnérable à la sécheresse. Dans cette zone, 72 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, tandis que la malnutrition sévit avec trois personnes sur quatre en situation d’insécurité alimentaire dans les deux régions.
À l’échelle nationale, les ménages dirigés par une femme sont plus vulnérables à l’insécurité alimentaire (18 % contre 15 % pour les ménages dirigés par un homme), en particulier les ménages dirigés par une seule personne dans les zones rurales (27 % contre 22 % pour ceux qui comptent deux membres ou plus).
Ainsi, les femmes sont particulièrement touchées par la pauvreté et le changement climatique. Au sein de la population rurale du Cameroun, 73% des femmes travaillent dans l’agriculture (principalement dans le secteur informel), mais seulement 22% ont des droits sur la terre à l’échelle nationale contre 19% dans le Nord, et ce, malgré l’existence de lois favorables à la propriété féminine. La répartition inégale de la terre entre les hommes et les femmes semble être ancrée dans un système patriarcal vivace.
Le changement climatique alourdit le fardeau des femmes qui doivent passer plus de temps à collecter du bois ou en quête d’eau, souvent en s’éloignant de leur domicile au risque de subir des violences physiques et sexuelles. La prévalence des violences basées sur le genre (VBG) au Cameroun est beaucoup plus élevée que la moyenne nationale, – 55% dans tout le pays Contre 60% dans le Nord.
Pourtant, une série de contraintes ont fait que le secteur agricole camerounais se caractérise par une faible productivité et une agriculture de subsistance à faible production, notamment dans le Nord et l’Extrême-Nord. La baisse de la fertilité des sols, l’utilisation limitée d’engrais, la faible adoption de variétés à haut rendement et l’usage quasi inexistant de techniques agricoles améliorées sont parmi les principales causes de ces faibles rendements.
Le développement et la gestion de l’irrigation au Cameroun n’ont pas évolué depuis les années 1980, contrairement à d’autres pays de la région. Il n’y a toujours pas de cadre institutionnel pour les associations d’usagers de l’eau (AUE), et les entreprises publiques (Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua, (SEMRY) dans l’Extrême-Nord et la Mission d’Études pour l’Aménagement et le Développement de la Région du Nord (MEADEN) dans le Nord) font presque tout le travail des agriculteurs, de la préparation des terres à la commercialisation du riz en passant par la prestation de services d’irrigation. Les résultats sont au mieux médiocres (si non insignifiants) par exemple, dans l’Extrême-Nord, ils ne peuvent récolter dans la zone irriguée qu’une fois par an (c’est-à-dire que l’intensité de la culture est à peine de 1).
Au niveau national, une nouvelle stratégie/politique d’irrigation est en cours de préparation par le Gouvernement autour de quatre axes principaux : (i) le développement et la réhabilitation de l’irrigation avec un transfert progressif de l’exploitation et de l’entretien des systèmes d’irrigation aux AUE d’irrigation ; (ii) le transfert des services de préparation des terres au secteur privé ; (iii) la promotion du secteur privé dans la commercialisation des chaînes de valeur agricoles (par exemple riz) ; et (iv) la révision du rôle du Gouvernement, en particulier des agences paraétatiques, telles que la MEADEN.
Des cinq zones agroécologiques du Cameroun, la zone soudano-sahélienne (Nord et Extrême- Nord) est celle où la saison des pluies est la plus courte (mars à septembre). Le renforcement de la résilience dans le bassin de la Bénoué est essentiel pour favoriser les changements d’activités et de comportements sociaux ou économiques nécessaires pour répondre efficacement aux pressions climatiques. L’hydro-système de la Bénoué joue un rôle important dans la résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes vulnérables, y compris leur capacité à mieux faire face et à s’adapter à l’impact des chocs et des facteurs de stress climatiques.
Dans cette zone, l’amélioration du stockage de l’eau, la collecte de l’eau et l’irrigation sont essentielles pour améliorer la production agricole. L’amélioration de la gestion de l’eau renforce également la capacité à résister aux chocs climatiques. Elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à promouvoir la production d’aliments de base dans les systèmes pluviaux et la production de céréales à haute valeur ajoutée (par exemple le riz), de cultures horticoles et de cultures industrielles dans les systèmes irrigués.
Avec un énorme potentiel inexploité pour l’irrigation (le réservoir de 5 900 millions de mètres3 de Lagdo), le développement de la vallée de la Bénoué, aura un impact significatif sur l’amélioration de la vie de centaines de milliers de personnes.
Le réservoir de Lagdo, retenu derrière le barrage éponyme, fournit de l’eau pour la production d’électricité pour l’irrigation des terres situées immédiatement en aval du barrage, sur les deux rives du fleuve. Il est également conçu pour assurer la modulation des crues. Le barrage multifonctionnel de Lagdo a été construit sur le fleuve Bénoué entre 1978 et 1982.
À son achèvement, le volume de stockage dans le réservoir retenu derrière le barrage était d’environ 7 700 millions de mètres cubes (m3), avec une allocation de 400 millions de m3 pour l’irrigation. La centrale hydroélectrique fonctionne depuis 1982, mais le développement de l’irrigation n’a pas eu lieu comme prévu à l’origine : seuls 200 ha ont été développés en 1987-89 et 800 ha en 1992-1993 sur la rive droite (RB). Le périmètre irrigué actuel compte à peine 600 ha d’irrigation fonctionnelle et est fondamentalement exploité par la MEADEN (exploitation complète du canal, préparation du terrain pour plus de 90 % des terres) sans entretien ni recouvrement des redevances d’irrigation de plus le système est en mauvais état.
La conception initiale du complexe du barrage de Lagdo prévoyait de fournir de l’eau d’irrigation (400 millions de m3) pour irriguer les terres situées sur les deux rives du fleuve immédiatement en aval. Les plans originaux prévoyaient l’irrigation par gravité d’environ 6 000 ha sur la rive droite et d’environ 5 000 ha sur la rive gauche. Cependant, seule une infrastructure d’irrigation limitée a été construite le long du RB, couvrant environ 1 000 ha dont seulement 600 ha peuvent actuellement être irrigués. Aucune infrastructure n’a été construite sur la rive gauche.
Bien que le Cameroun dispose d’un fort potentiel d’augmentation de la productivité agricole, il est un importateur net de nombreuses denrées alimentaires, en particulier de riz, ne produisant actuellement qu’environ un cinquième de ses besoins.
Ainsi, le projet Viva Bénoué va s’atteler à :
- Promouvoir l’irrigation, l’amélioration des pratiques agricoles et des moyens de subsistance des agriculteurs dans le cadre d’une approche intégrée. L’irrigation sera développée à partir des réservoirs déjà aménagés sur la rivière Bénoué, ce qui permettra de se prémunir contre les effets du changement climatique et contre l’augmentation des sécheresses. Les composantes du projet sont alignées sur le développement et la diffusion de nouvelles technologies agricoles, l’agriculture résiliente au climat et l’amélioration des liens avec le marché pour les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux ;
- Produire des effets positifs en termes de protection de l’environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la diffusion de systèmes d’irrigation à haut rendement, qui diminuent considérablement la consommation d’eau ;
- améliorer la durabilité et la fiabilité de l’agriculture pluviale et de l’agriculture irriguée à petite échelle dans la vallée de la rivière Bénoué en aval du barrage de Lagdo, comme au Nigeria, avec de meilleures caractéristiques de protection contre les inondations ;
- maximiser le financement du développement en promouvant le rôle du secteur privé dans des domaines clés et en optimisant l’utilisation de ressources publiques limitées. Le sous-secteur du riz au Cameroun a un fort potentiel de croissance si la chaîne de valeur, et en particulier la transformation locale, peut être améliorée ;
- à promouvoir la participation du secteur privé (PSP) dans des domaines clés où elle a une valeur ajoutée évidente et où la MEADEN a opéré jusqu’à présent avec de faibles résultats ;
- Par le biais de bons d’achat et d’autres subventions, le projet renforce la capacité des populations pauvres à faire face à des menaces.
Par ailleurs, le Gouvernement vise la réduction aux importations en équilibrant la modernisation de l’agriculture avec le recours aux ressources et à la main-d’œuvre du pays. Un accent particulier sera mis sur l’augmentation de la production des cultures vivrières (riz, maïs, sorgho, féculents), du bétail et des produits de la pêche.
Le projet Viva Bénoué fait partie intégrante du soutien à la réponse à la crise du GBM. Le projet participe de son deuxième pilier thématique, qui consiste à protéger les personnes pauvres et vulnérables de l’impact de la crise économique et sociale déclenchée par la pandémie.
